|
Peut-être apparue
à Alexandrie au début du IIIe siècle avant
J. C., la mosaïque constitue un élément essentiel
de la richesse ornementale de la maison privée et des
édifices publics pompéiens. Les mosaïques
romaines furent d'abord réalisées en pierres précieuses
(émeraudes, turquoises, agates, cornalines…), mais
on chercha vite des matériaux moins coûteux et on
employa des tesselles faites en pâte de verre. |
 |
|
|
acteurs |
|
Le pavimentum
sectile est composé de morceaux de marbre de couleurs
variées fixés sur le sol ou contre les murs au
moyen d'une colle. Ces segments peuvent prendre des formes géométriques
diverses : triangles (trigoni), carrés (abaci,
quadrati), losanges (rhombi, scutulae),
hexagones (favi), cercles, demi-cercles, quarts de cercle
(orbes). Ils sont alors assemblés en damiers (opus
pavimentum ou quadratarium), en étoiles (scutulatum)
ou en épis (spicatum). |
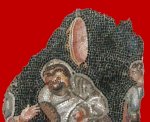 |
|
|
acteur
comique |
|
La technique se complique
quand on passe du décor abstrait à l'incrustation
de véritables tableaux : on ajoure d'abord une dalle de
marbre en suivant les contours d'un poncif ; puis on comble les
vides ainsi obtenus avec des plaquettes (crustae) découpées
dans un marbre différent ou dans du lapis-lazuli, de la
serpentine, de la malachite, de l'albâtre. |
 |
|
|
masque |
|
Ce genre de revêtement
architectural ne convient guère qu'aux parois verticales
et planes. Pour l'adapter aux formes creuses ou bombées
des absides ou des voûtes, on diminue peu à peu
la taille des crustae et on simplifie leur forme pour
en venir à adopter le carreau (abacus ou tessera)
qui devient, en diminuant de volume, l'abaculus, la tesserula
ou tessella. |
 |
|
|
masque |
|
C'est ainsi que
le perfectionnement de l'opus sectile aboutit au pavimentum
tessellatum (pavement historié) ou au musivum
(mosaïque murale) dont tous les fragments sont de forme
cubique. |
 |
|
|
musiciens
des rues |
|
L'opus tessellatum
est issu à la fois de l'opus sectile et de l'opus
signinum (mélange de brique pilée et de chaux
incrusté de lapilli ou de fragments de marbre). |
 |
|
|
chez
la sorcière |
|
Ce dernier était
utilisé, à l'origine, pour indiquer les principales
divisions des appartements, les seuils de la maison, de la cour
et des chambres, les limites de l'impluvium, l'emplacement
des lits et de la table dans le triclinium, de l'alcôve
dans le cubiculum. |
 |
|
|
l'école
d'Athènes |
|
Le pavimentum
tessellatum resta longtemps cantonné dans la gamme
des tons habituels de l'opus sectile, le noir et le blanc,
relevés de quelques notes rouges, jaunes et olivâtres
et formé de cubes groupés en séries compactes
et symétriques. Il exclut le modelé, le relief
et la perspective. |
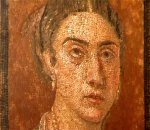 |
|
|
portrait
de femme |
|
Tout autre est
le pavimentum vermiculatum dont les fragments suivent
les contours du dessin pour reproduire les effets de la peinture
et rendre avec des cubes de verre et de pierre le jeu des couleurs,
les effets de l'ombre et de la lumière ainsi que les savantes
constructions de la perspective. |
 |
|
|
Thésée
et le minotaure |
|
Il s'agit de
réaliser l'équivalent de véritables tableaux
de chevalet en s'inspirant de la nature : ces emblemata,
faits pour charmer les yeux, sont presque toujours isolés
par un cadre, entourés de larges bandes d'opus sectile
ou de tessellatum si bien que les deux genres réagissent
l'un sur l'autre et finissent par se confondre. |
 |
|
|
lion |
|
Qu'elles couvrent le
sol des pièces de réception ou qu'elles décorent
murs, voûtes et fontaines, ces mosaïques offrent le
plus souvent aux regards des scènes figurées en
harmonie avec la destination des espaces ainsi décorés
: scènes mythologiques dans les temples, scènes
marines dans les thermes, chiens dans les vestibules, natures
mortes et scènes dionysiaques dans les salles à
manger, scènes érotiques dans les chambres. |
 |
|
|
tête
de Gorgone |
|
Sur les murs des cubicula
et des tablina, on compose des tableaux originaux, des
scènes de genre et l'on reproduit les œuvres des
maîtres alexandrins. |
 |
|
|
tête
de jeune homme |
|
Tout, d'ailleurs, est
alexandrin dans ces emblemata : thèmes, personnages,
nature habitée par les nymphes et les satyres, |
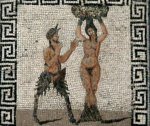 |
|
|
satyre
et nymphe |
|
paysages nilotiques
peuplés d'ibis, d'hippopotames et de crocodiles, |
 |
|
|
scène nilotique |
|
canards nageant au milieu des plantes
aquatiques... |
 |
|
|
canards |
|
Les divinités
représentées sont celles que l'homme s'associe
dans toutes les circonstances familières : ici, Dionysos
et les génies bachiques, ailleurs, Neptune et Amphitrite,
Aphrodite et les Amours ou encore les demi-dieux qui symbolisent
les forces de la nature : Fleuves et Montagnes, Nymphes et Faunes,
Tritons et Néréides. |
 |
|
|
Dionysos |
|
C'est aux distractions
favorites des Grecs que se rapportent la plupart des tableaux
de genre de la période augustéenne, ceux qui figurent
les scènes de théâtre, les luttes de la palestre
ou les combats de coqs. |
 |
|
|
combat de
coqs |
|
Certains tableaux célèbrent
la gloire militaire de la Grèce, comme la mosaïque
d'Alexandre à la bataille d'Issos. D'autres, on
l'a vu plus haut, célèbrent sa gloire littéraire
avec L'Ecole d'Athènes ou Académie de
Platon. |
 |
|
|
Alexandre |
|
De nombreux motifs
sont empruntés aux légendes helléniques,
comme celle de Thésée et du Minotaure déjà
évoquée. D'autres renvoient aux principaux événements
du cycle troyen, le jugement de Pâris, l'enlèvement
d'Hélène, le sacrifice d'Iphigénie, Achille
tirant son épée contre Agamemnon, Achille reconnu
par Ulysse ou accueillant les supplications de Priam. |
 |
|
|
Achille tirant
son épée |
|
Mais la mosaïque peut aussi
se faire support de la méditation philosophique invitant
les mortels,
au milieu des plaisirs de la table, à se souvenir que
la vie est courte... |
 |
|
|
squelette |
|
... et qu'il faut en
jouir ici et maintenant, avant que la mort ne s'invite au banquet
! |
 |
|
|
memento mori |

